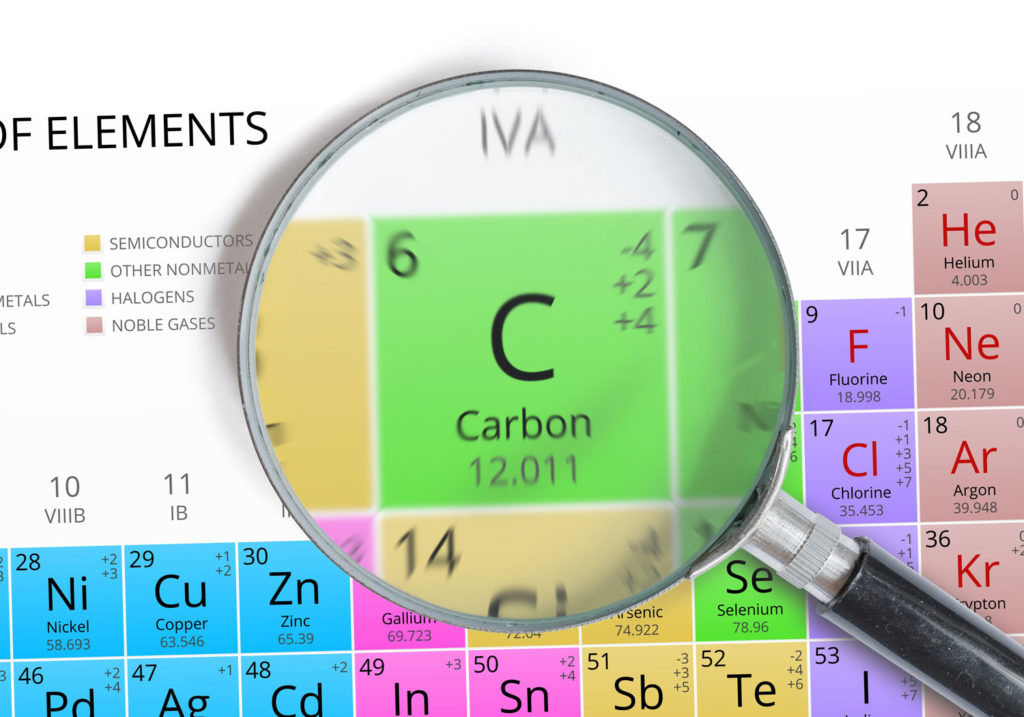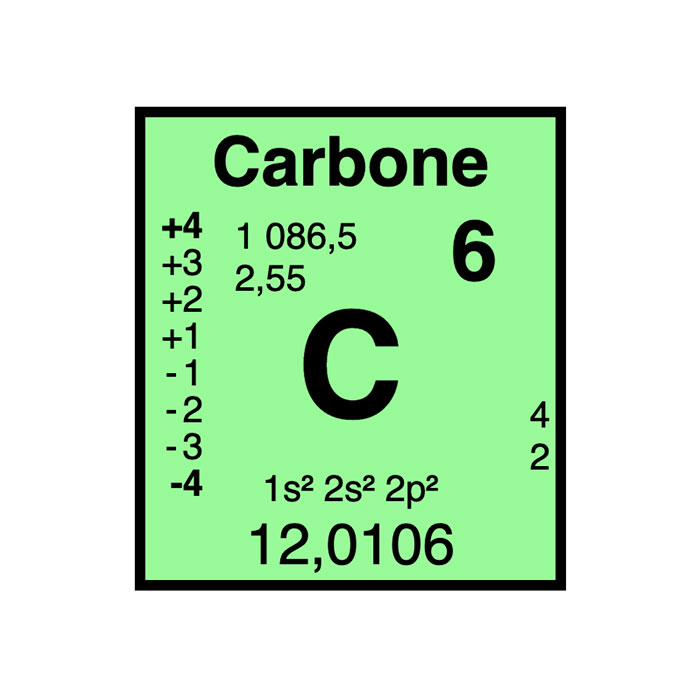
Caractéristiques du carbone
- Symbole : C
- Masse atomique : 12,010 74 ± 0,000 8 u1,2
- Numéro CAS : 7440-44-08
- Configuration électronique : [He]2s22p2
- Numéro atomique : 6
- Groupe : 14
- Bloc : Bloc P
- Famille d’éléments : Non-métal
- Électronégativité : 2,55
- Point de fusion : 3,546.9°C