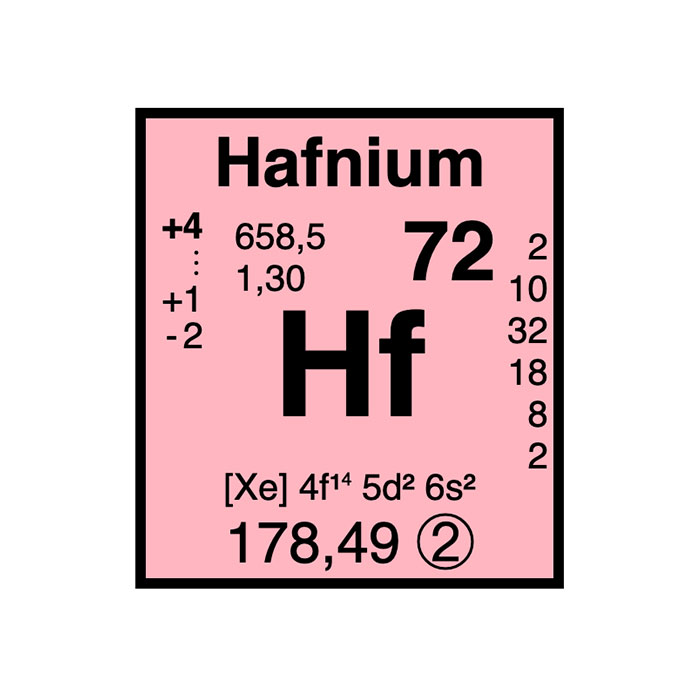
Caractéristiques du hafnium
- Symbole : Hf
- Masse atomique : 178,49 ± 0,02 u
- Numéro CAS : 7440-58-6
- Configuration électronique : [Xe]4f14 5d1 6s2
- Numéro atomique : 72
- Groupe : 4
- Bloc : Bloc f
- Famille d’éléments : Métal de transition
- Électronégativité : 1,3
- Point de fusion : 2 233 °C

