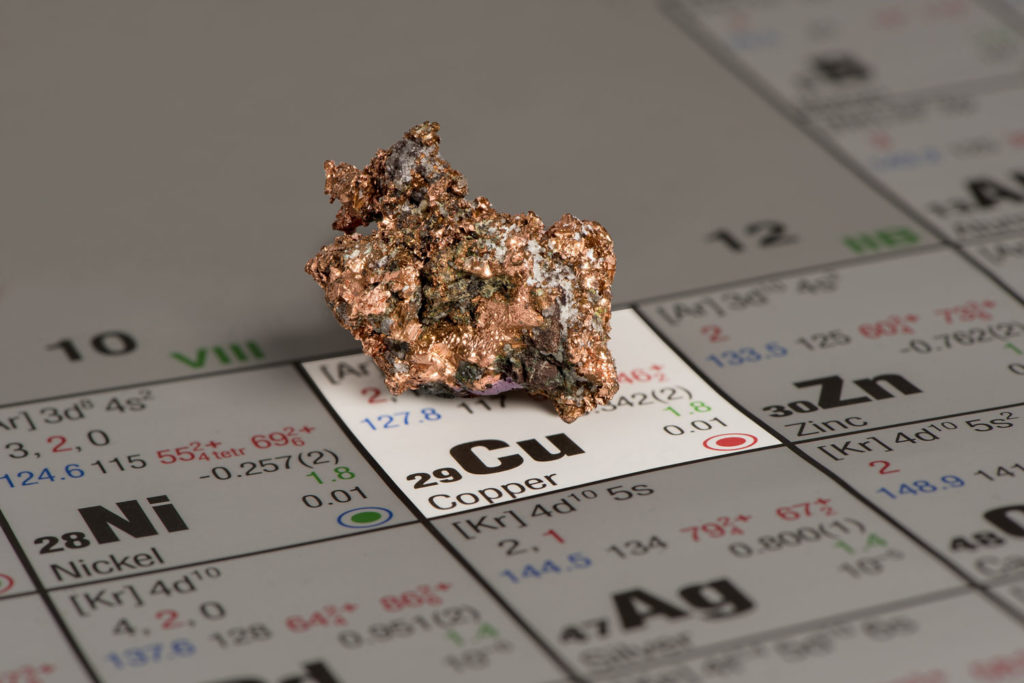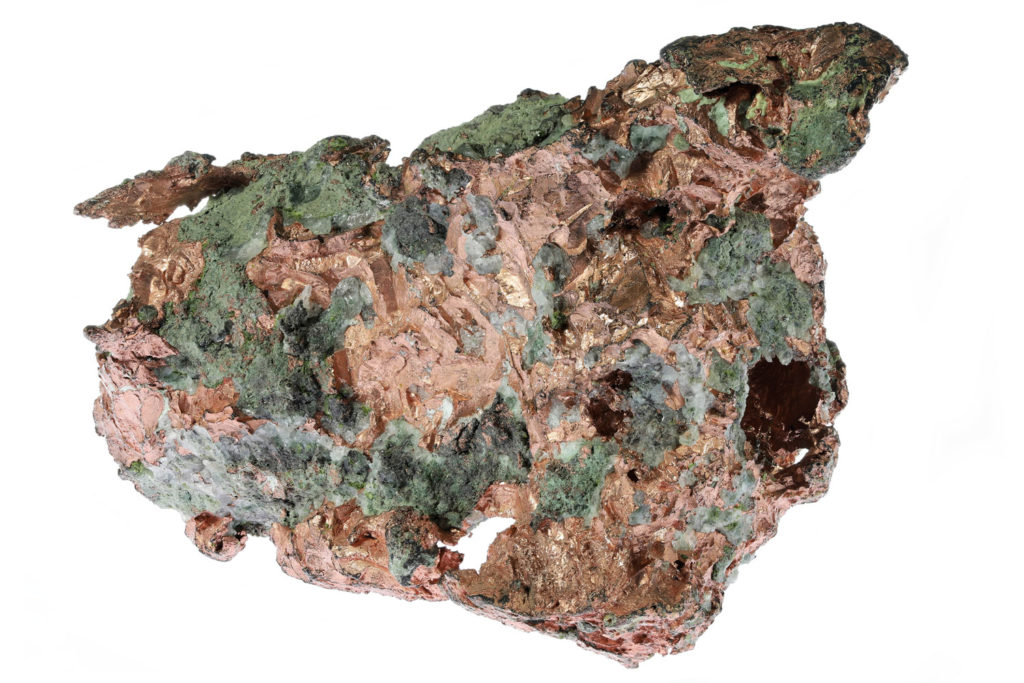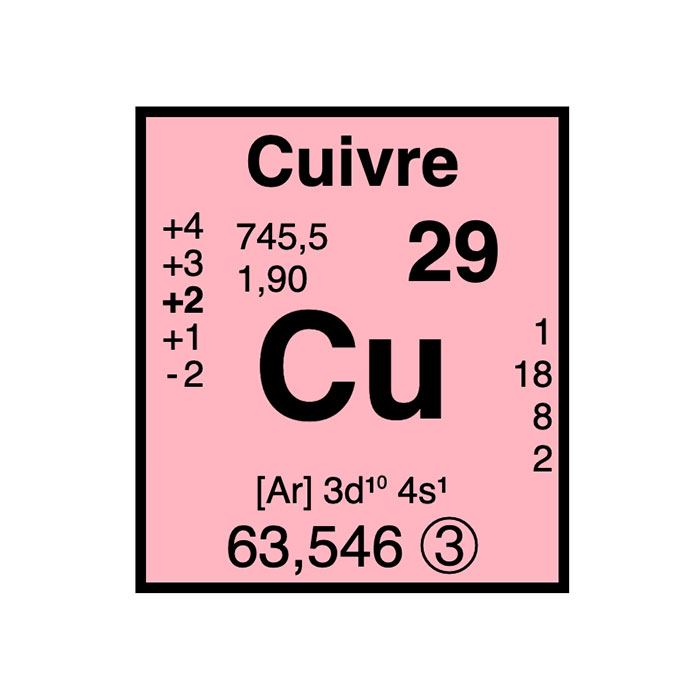
Caractéristiques du cuivre
- Symbole : Cu
- Masse atomique : 63,546 ± 0,003 u
- Numéro CAS : 7440-50-8
- Configuration électronique : [Ar] 4d10 4s1
- Numéro atomique : 29
- Groupe : 11
- Bloc : Bloc d
- Famille d’éléments : Métal pauvre ou métal de transition
- Électronégativité : 1,9
- Point de fusion : 1084,62 °C (congélation)