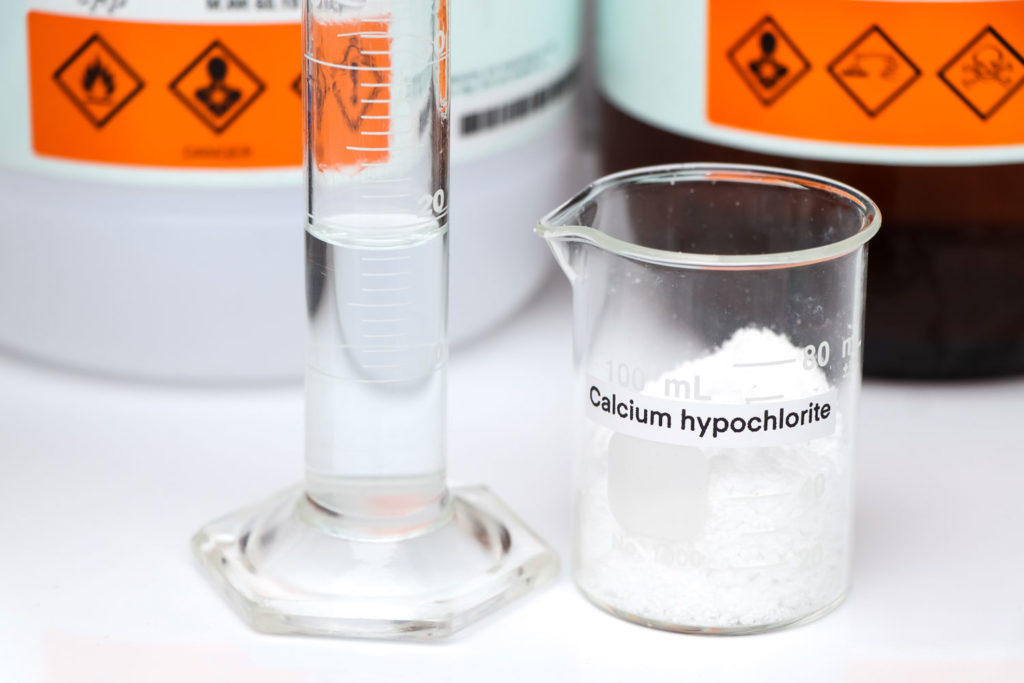Caractéristiques du calcium
- Symbole : Ca
- Masse atomique : 40,078 ± 0,004 u1
- Numéro CAS : 7440-70-24
- Configuration électronique : [Ar]4s2
- Numéro atomique : 20
- Groupe : 2
- Bloc : Bloc S
- Famille d’éléments : Métal alcalino-terreux
- Électronégativité : 1,00
- Point de fusion : 842 °C1