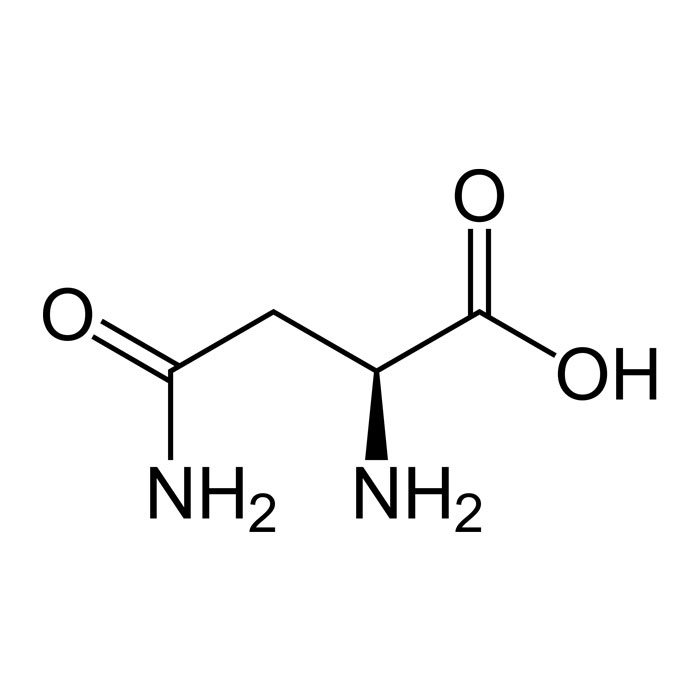
Caractéristiques de l’asparagine
-
Identification de l’asparagine :
- Nom UICPA : Asparagine
- Synonymes : L-asparagine, althéine, acide (2S)-2-amino-3-carbamoylpropanoïque
- N° CAS : 5794-13-8
- N° ECHA : 100.019.565
- N° CE : 218-163-3
- Code ATC : L01XX02
- PubChem : 439600
- ChEBI : 28169
- FEMA : 24867667
- SMILES :NC(=O)CC(N)C(=O)O
- InChl : 1/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Propriétés chimiques :
- Formule : C4H8N2O3 [Isomères]
- Masse molaire : 132,117 9 ± 0,005 1 g/mol C 36,36 %, H 6,1 %, N 21,2 %, O 36,33 %,
- pKa : l-Asparagine : pKa1=2,16, pKa2=8,73 à 25 °C
Propriétés physiques :
- T° Fusion : 235 °C
- Solubilité : 25,1 g·kg-1
Propriétés biochimiques :
- Codons : AAU, AAC
- pH isoélectrique : 5,41
- Acide aminé essentiel : Non
- Occurrence chez les vertébrés : 4,4 %
Propriétés optiques :
- Pouvoir rotatoire : –
Précautions :
- SIMDUT : Produit non contrôlé [+] Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.