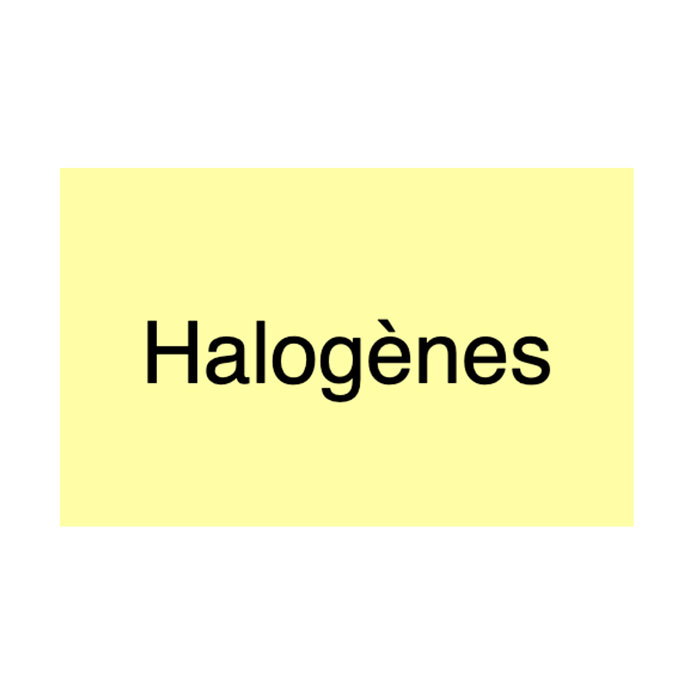
Caractéristiques des halogènes
- Les halogènes figurent dans la 17e colonne du tableau périodique.
- Ils sont constitués de l’astate 85At, de l’iode 53I, du brome 35Br, du fluor 9F, du chlore 17Cl et du tennesse 117Ts.
- Les deux premiers éléments sont particulièrement radioactifs.
- Le terme « halogène » provient du grec hals qui signifie sel, et gennân synonyme de « engendrer ».


